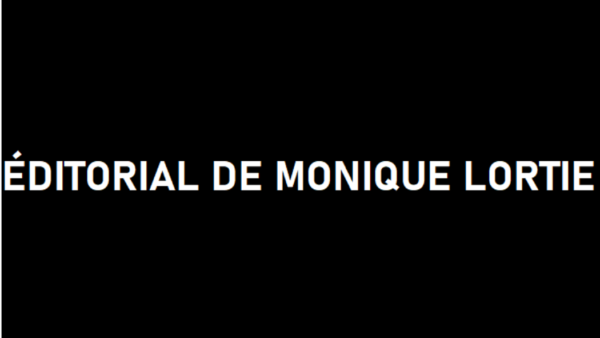
Chagrin secret, incommunicable, qui nous enferme comme dans un univers à part : le monde du deuil.
On peut douter que le problème de la mort soit à proprement parler un problème philosophique. Mais, est-il davantage médical ? Et ces jours-ci, en pleine pandémie, alors que la mort menace ; alors qu’on nous raconte avec éloquence les statistiques de ce que l’on appelle abstraitement « la mortalité » ; alors que l’on compare notre mortalité québécoise à celle de l’Ontario, ou à celle de l’Italie ; pouvons-nous dire avec les médias que le problème de la mort soit un problème de santé publique ? économique ? en somme un problème administratif comme les autres, et donc banal ? Et gérable ?
Le médecin, lui-même, ne sait rien de la mort, il sait soigner la maladie. Passé ce seuil, le médecin est comme nous tous, il ignore. Il est sans lumière, comme nous tous, devant le mystère inénarrable de la mort.
Comme nous tous ? Pas tout à fait. Car nous tous, cela signifie une personne à la fois, une personne unique et terriblement seule, qui, ce jour-là, – ce jeudi-ci, 16 juillet 2020 à dix heures, cinquante-cinq minutes, comme en témoigne Serge Bouchard à la dernière ligne de son dernier livre -, reçoit dans sa chair la douleur incommensurable de la disparition pure et simple et à jamais, d’une personne aimée tendrement. Idem pour la fille, le fils, les petits-enfants de cette dame âgée et fragile, décédée toute seule dans son confinement sanitaire gouvernemental.
« La mort », dira le philosophe Jankélévitch, « est un vide qui se creuse brusquement en pleine continuation d’être ; l’existant rendu soudain invisible s’abîme en un clin d’œil dans la trappe du non-être. »
Pourtant la mort, pour incompréhensible qu’elle soit, nous, qui vivons encore, nous la connaissons très bien : par la douleur infinie qui vient de la perte, par le chagrin qui s’installe à demeure chez nous. Chagrin secret, incommunicable, qui nous enferme comme dans un univers à part : le monde du deuil.
Voilà le grand mot lâché : le deuil ! J’ai bien peur que dans notre ignorance nihiliste d’aujourd’hui nous n’ayons détourné ce mot de son sens profond : « deuil » est un vieux mot latin pour signifier la « douleur » : dolere, souffrir, gémir, recevoir des coups, dolor.
N’est-ce pas comme ça, en réalité, que nous recevons dans notre corps, dans nos tripes, dans notre âme, la réalité réelle de la mort de la personne aimée : un coup qui nous désoriente totalement ?
Mais voilà qu’a surgi un « protocole » censé nous aider à « traverser », ou mieux, à « aller au-delà » de cette précieuse douleur. Afin de « passer à autre chose »…
On nous propose le chemin dit des 5 étapes : Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Et ces « 5 étapes du deuil » sont à ce point entrées dans la culture populaire qu’on a oublié qu’à l’origine, elles ne voulaient absolument pas dire ce qu’on leur fait dire aujourd’hui.
L’auteure de ce modèle est la respectée psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Dans un livre publié en 1969, elle résume le processus qu’on a fini par appeler « les cinq étapes du deuil » mais qui décrivait en réalité l’observation faite par elle d’états mentaux par lesquels passe la personne malade à qui l’on vient d’annoncer qu’elle va mourir.
Aujourd’hui, le modèle Kübler-Ross en cinq phases qui se voulait purement descriptif dans la maladie est devenu, à tort, « prescriptif » auprès des personnes frappées par le deuil*. La nuance est de taille, non ?
Dites-moi, aurai-je réussi à montrer aux endeuillés de la pandémie actuelle qu’un modèle objectif ne convient pas et ne conviendra jamais à gérer* ma peine d’avoir perdu une personne aimée qui, elle, est tout sauf objective ?
* Agence Science Presse – Pascal Lapointe
* Gérer : quel mot affreux s’agissant de la peine !
MONIQUE LORTIE, M.A. phi.


Les pas de la Sainteté dans l’Humanisation au/du quotidien